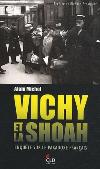le Glossaire de Francis a trouvé :
Asher (Serge) - Résistance (France) |
| - | Serge Asher est mieux connu sous le nom de Serge Ravanel, son pseudonyme de résistant. (voir sous Ravanel)
|
| - | Ecrivain (1895-1981). Né à Corfou, il émigre avec sa famille dans le midi de la France. Au lycée, il aura comme condisciple Marcel Pagnol avant de poursuivre des études de droit à Genève. Il prendra la nationalité suisse en 1919. L'écrivain s'est consacré à imaginer l'épopée de ceux qu'il appellera, au titre d'un de ses romans, "Les Valeureux". En 1968, son roman "Belle du Seigneur" obtint le grand prix du Roman de l'Académie française.
|
| - | Dans le cadre de l'organisation de la Résistance, la lettre R suivie de 1 à 6 indiquait une région de la zone Sud (zone non occupée jusqu'en 1942).
R1 : Région Rhône-Alpes (centre Lyon).
R2 : Région Provence-Côte d'Azur (centre Marseille).
R3 : Région Languedoc-Roussillon (centre Montpellier).
R4 : Région du Sud-Ouest (centre Toulouse).
R5 : Région de Limoges (centre Brives puis Limoges).
R6 : Région de l'Auvergne (centre Clermont-Ferrand).
En zone Nord occupée, les régions étaient définies par les simples lettres : P - A - B - C - D - M
(voir "zone")
|
Dans ce texte : Que savait Vichy ? de Emmanuel de Chambost le lundi 09 avril 2012 à 23h53 Que savait Vichy ? de Emmanuel de Chambost le lundi 09 avril 2012 à 23h53
La question « En France, qui savait quoi ? » n'est pas aussi simple qu'il y parait
Alain Michel, p.238: « Mais tout d'abord une remarque générale importante: sur le sujet de la connaissance de la Shoah, on confond en général l'information et la compréhension de l'information qui sont deux choses différentes ... Même si l'information commence à circuler, cela ne veut pas dire qu'elle est assimilée et décryptée. Ce qui est valable pour l'homme de la rue, et même pour les victimes, est valable également, au moins partiellement pour les dirigeants... »
Alain Michel cite ensuite Peschanski (Que savait Vichy ? 1987)
« On voit dans la politique de Laval comme un condensé de la politique qu'il a tenté de mettre en œuvre. Gardant toujours en tête le projet d'une grande négociation franco-allemande, il a disposé d'un atout supplémentaire en donnant en gage ceux dont au bout du compte, il voulait se débarrasser. Au prix d'un massacre ? Ce n'était sans doute pas clair dans son esprit les premiers mois: après, ce fut secondaire, et il était pris dans l'engrenage. »
Sur ce point, Michel reprend le point de vue exprimé par Asher Cohen (Persécutions et sauvetages, 1993, p.316), après avoir traité les déportations de l'été 1942.
« Avant de reprendre le fil des évènements ... demandons-nous ce que savaient les gens, surtout les Juifs, de la Solutions finale et des réalités de la politique antijuive allemande exécutée en même temps en Pologne. En d'autres termes, que savait-on de ce qui était advenu aux déportés de France et de ce qui attendait les suivants ? En fait, la question se dédouble: Quelle information était accessible en France ? et qu'en avait-on compris ? Sur la première question, nous en savons plus, mais c'est la seconde qui est vitale. Car ce n'est qu'après avoir analysé l'appréhension des évènements qu'on saura apprécier et comprendre les actions des uns et des autres en face d'une situation toute nouvelle... »
Emmanuel *** / *** |



 Temps entre début et fin du script : 0.05 s 3 requêtes
Temps entre début et fin du script : 0.05 s 3 requêtes